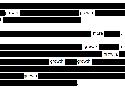Andreessen’s Techno-Optimist Manifesto as Redaction Poetry — Ben Grosser
July 31, 2024 at 11:27:46 AM GMT+2
*
FILLER
Après le boycott de Zaho de Sagazan, 500 artistes appellent à “s’élever” contre “l’intimidation” de Bolloré
Source : Musique : actus, critiques musicale et sélections d'albums
July 29, 2024 at 3:32:09 PM GMT+2
*
FILLER
Conseils de base pour situation de crise (législative) – Nothing2Hide
Un peu en retard mais toujours pertinent néanmoins !
https://nothing2hide.org/fr/2024/06/27/protection-en-ligne-conseils-de-base-pour-situation-de-crise/
July 29, 2024 at 3:20:59 PM GMT+2
*
FILLER
Le rapport ambivalent des Français à l’information, aux médias et aux journalistes
July 29, 2024 at 3:18:15 PM GMT+2
*
FILLER
Webinaires Parcours Framasoft / Hubikoop
Captation des 8 webinaires du parcours d'accompagnement à la découverte de services numériques éthiques proposés par Framasoft et Hubikoop entre septembre 2022 et février 2023
July 29, 2024 at 10:53:58 AM GMT+2
*
FILLER
Rasphone - Livre d'or audio sur téléphone
Un très chouette projet initié et suivi chez nous à Agate :)
July 29, 2024 at 9:46:04 AM GMT+2
*
FILLER
Numérique et décarbonation : je t’aime moi non plus [€]
Source : Next - Flux Complet
July 21, 2024 at 10:02:56 AM GMT+2
*
FILLER
Le libre s’inquiète pour ses financements européens - Next
July 18, 2024 at 12:09:18 PM GMT+2
*
FILLER
Le ticket de métro augmente à 4 euros dans quelques jours : comment faire le plein de tickets à 1,73 euro ? - Numerama
July 18, 2024 at 11:21:29 AM GMT+2
*
FILLER
Les professionnels de la transition écologique au bord du burn-out
July 18, 2024 at 11:09:11 AM GMT+2
*
FILLER
Calculating Empires - A Genealogy of Technology and Power Since 1500
Via Sebsauvage
July 17, 2024 at 8:08:04 PM GMT+2
*
FILLER
Vidéosurveillance (1/3) : des caméras toujours plus nombreuses et intrusives
Source : Next - Flux Complet
July 16, 2024 at 5:19:37 PM GMT+2
*
FILLER
Réaliser une conférence gesticulée collective sur le syndicalisme
Source : L'ardeur
July 15, 2024 at 8:43:18 PM GMT+2
*
FILLER
« Dark patterns » : « la grande majorité des sites Web » manipulent leurs usagers, selon une étude internationale
De nombreux éditeurs de sites web ne proposent pas de politique de confidentialité claire, découragent le refus du suivi publicitaire et empêchent parfois la désinscription.
July 14, 2024 at 12:51:17 PM GMT+2
*
FILLER